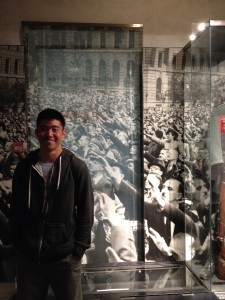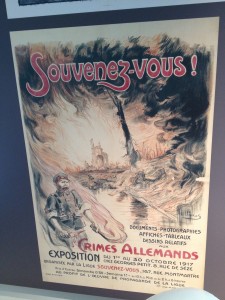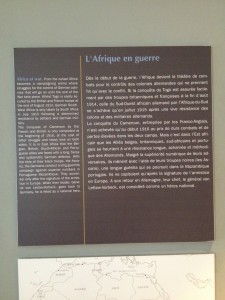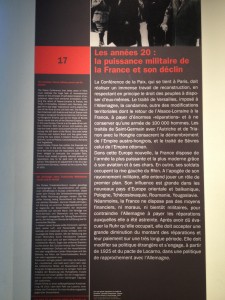Le son du bavardage reste constant tandis que la musique entraînante de l’une des brasseries, parvient jusqu’à la place. À droite, une fontaine sculptée, qui dépeint une femme puissante, essayant activement de monter quatre chevaux féroces et irrépressibles. La musique de la fanfare et du patriotisme continue de jouer qui permette à elle, la France, de diriger et contrôler les quatre grandes rivières du pays : la Seine, la Loire, le Rhône et la Garonne.
Soudainement, la musique change ; la force de la pression de l’eau a diminué ; le son de l’écoulement de la fontaine devient graduellement engourdissant ; un petit homme qui s’assoit en buvant son bière commence à fumer une cigarette. En transition, le bruit de la conversation entre les gens qui parlent semble mélangé à l’air rythmique de la nouvelle chanson.
Le soleil, qui brille fort, anime les couleurs monotones et pâles de la fontaine Bartholdi. En contrepartie, cette énergie déchaînée arrive à l’esprit de chaque personne et crée une ambiance vivante et pleine d’enthousiasme. Devant la fontaine, l’hôtel de ville se tient debout en gardant la place avec un œil vigilant. Le drapeau, qui reste sur la structure architecturale en forme de dôme, flotte au vent violemment contre le côté droit, comme il reste statique avec les petites rides qui glissent à travers successivement le bleu, le blanc et le rouge. Les statues et les figures sculptées sur ce grand monument historique regardent fixement vers le bas les piétons et les clients qui ne sont indifférents à leur présence.
Sans aucun doute, c’est un vent à décorner les cocus. En haut, les nuages commencent à se disperser et à converger pendant que les petites ouvertures du ciel bleu jettent rapidement un coup d’œil sur la place. Des nuages plus épais flottent tandis que des nuages fins et clairsemés courent à travers le ciel vers la ligne d’arrivée invisible. Au ras du sol, presque tous les sets de table crèvent d’envie de s’envoler, mais ils ont été maitrisés par les bouteilles ou les verres posés à chaque coin. Même les parasols fermés, qui fournissent de l’ombre, remuent doucement dans une position inclinée comme une robe fripée.
Une fois de plus, la musique change et devient plus calme. Le coup de vent diminue. Les rabats attachés sur les côtes des auvents claquent mélodiquement comme le mouvement d’un oiseau battant des ailes. Directement en-dessous des grands auvents qui protègent les gens qui mange de la force du vent et qui bloque la vue de l’entrée du musée des beaux-arts, l’ombre de ces rabats, qui est reflétée sur le plancher, se cache son image mystérieuse de l’éclat du soleil. La faiblesse du vent, pour l’instant, permet aux déchets qui tombent sur le sol de sautiller plus légèrement que le moment auparavant. La fumée de la cigarette du petit homme s’intensifie ; la chaleur du soleil produit une sensation hypnotisant ; et l’odeur de la nourriture commence à remplir l’air. C’est ici à la place des Terreaux où l’on peut éviter le despotisme de la pensée consciente.